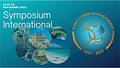Le premier objectif se justifie par les effets délétères de l’inflation sur la croissance des économies et sur le niveau de pauvreté ; le second, par la nécessité d’équilibrer la balance des paiements lorsque les réserves extérieures s’épuisent.
Certains économistes ont soutenu qu’une dépréciation systématique de la monnaie, en vue de maintenir un taux de change réel bas, serait nécessaire à la croissance des pays en développement, notamment de ceux à faible revenu (Rodrik, 2008). La dépréciation du taux de change effectif réel revient à élever le prix relatif des biens faisant l’objet du commerce international (ou biens échangeables) par rapport aux biens locaux ou non échangeables (une grande part des services). Cette politique se justifierait par les handicaps particuliers des secteurs des biens échangeables, notamment de l’industrie dans les pays en développement, dont dépend la croissance : des mauvaises institutions qui nuisent à la fiabilité des contrats et des imperfections ou défaillances de marché (biens, crédits, travail). Dany Rodrik appuie son argumentaire sur l’expérience chinoise jusqu’en 1994. Cette thèse en faveur de la dépréciation a été critiquée, notamment parce qu’elle serait défavorable aux plus pauvres particulièrement impactés par la dépréciation réelle, néfaste aux institutions et source de corruption et, enfin, difficile à maintenir dans le temps long.
À l’époque, et encore maintenant, peu de travaux s’interrogent sur l’impact d’une telle politique sur le climat. Existe-t-il un lien entre la politique du taux de change et l’efficacité des politiques d’atténuation du réchauffement climatique ou d’adaptation à celui-ci ? C’est à ces deux questions que nous allons tenter de répondre, de façon tout à fait exploratoire en l’absence d’une littérature confirmée sur ce sujet.
Guillaumont Jeanneney S. (2023) « Politique de change et réchauffement climatique », Ferdi Note brève B256, octobre.