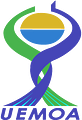Document réalisé pour la Commission de l’UEMOA dans le cadre de la convention Ferdi - UEMOA.
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) fait face à des vulnérabilités persistantes qui freinent durablement le développement de ses États membres et limitent leur capacité à absorber les chocs exogènes.
Ces vulnérabilités, de nature économique, environnementale et sociale, s’inscrivent dans un contexte international instable caractérisé par l’intensification des risques climatiques, la récurrence des crises sanitaires, les tensions géopolitiques et une volatilité marquée des marchés internationaux. Ce rapport propose une analyse approfondie des vulnérabilités et de la résilience des huit États membres, reposant sur une approche comparative et multidimensionnelle qui associe des indices quantitatifs rigoureusement construits à une analyse contextuelle des spécificités nationales, dans l’objectif précis d’éclairer les choix politiques à l’échelle nationale et régionale.
Pour saisir précisément les facteurs qui exposent les pays aux chocs et influencent leur capacité de réponse, l’analyse distingue clairement deux grandes catégories de déterminants : d’une part, les facteurs structurels, profondément enracinés dans les caractéristiques géographiques, démographiques et économiques des pays, peu modifiables à court terme ; d’autre part, les déterminants liés à la politique présente, sur lesquels les États peuvent agir de manière plus immédiate. Cette distinction permet d’identifier les contraintes les plus durables et les leviers d’action prioritaires. La résilience est examinée à travers cette même logique duale: une dimension structurelle, liée notamment au capital humain et à la taille des marchés, et une dimension non structurelle, liée à la qualité de la gouvernance, à la solidité institutionnelle et à l’efficacité des politiques publiques.
La méthodologie employée mobilise des indices quantitatifs élaborés dans le cadre de l’Observatoire des vulnérabilités et de la résilience de la Ferdi. Ces indices suivent une procédure rigoureuse de sélection, de standardisation et d’agrégation des données afin d’assurer une comparaison objective entre pays, tout en intégrant les spécificités contextuelles de chaque État membre. L’utilisation de cette méthodologie permet une évaluation précise des vulnérabilités structurelles et générales ainsi que des capacités de résilience des pays étudiés.
L’analyse révèle tout d’abord une forte vulnérabilité économique au sein de l’espace UEMOA, marquée par une concentration élevée des exportations sur quelques produits primaires, une dépendance critique à certaines importations stratégiques et une grande sensibilité aux variations des termes de l’échange. Cette fragilité est accentuée par un déficit de diversification productive et une intégration encore limitée aux marchés internationaux, ce qui restreint les marges d’ajustement en cas de choc. La vulnérabilité environnementale s’aggrave également, sous l’effet conjugué du changement climatique, de l’intensification des pressions exercées sur les ressources naturelles et de la fréquence accrue d’événements extrêmes tels que sécheresses prolongées, inondations sévères et dégradation accélérée des sols. Les régions littorales et sahéliennes apparaissent particulièrement exposées, avec des impacts concrets sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des populations et la viabilité des infrastructures économiques essentielles.
Sur le plan social, entendu ici dans sa dimension également sociétale, les pays de l’UEMOA font face à des vulnérabilités croissantes, alimentées par l’insécurité interne, la fragilité persistante des systèmes de santé, la pression démographique accrue et les déplacements forcés de populations. Les tensions identitaires et la progression du terrorisme, conjuguées à une urbanisation rapide mais peu maîtrisée, compliquent encore davantage les efforts visant à renforcer la cohésion sociale. Ces difficultés sont exacerbées par la faiblesse des systèmes de protection sociale et par l’inégale répartition territoriale des services publics de base.
Concernant la résilience, les États membres de l’UEMOA présentent globalement des niveaux structurellement faibles, principalement en raison du capital humain limité, de la faible taille des marchés intérieurs et des contraintes spécifiques des pays enclavés, tels que le Mali, le Niger ou le Burkina Faso. Toutefois, l’analyse révèle des différences notables entre les pays. Certains États comme le Sénégal, le Bénin ou la Côte d’Ivoire affichent une résilience non structurelle relativement meilleure, portée par des politiques publiques plus efficaces, une gouvernance plus réactive et une capacité institutionnelle accrue. Ces différences illustrent l’importance déterminante de la qualité des politiques publiques et de la solidité institutionnelle pour expliquer les écarts de résilience observés au sein de l’Union.
En croisant ces dimensions de vulnérabilité et de résilience, le rapport établit une typologie des pays de l’UEMOA, replacée dans un contexte plus large des pays en développement. Quatre pays – le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau – se caractérisent par une vulnérabilité structurelle élevée cumulée à une faible résilience non structurelle. À l’opposé, le Bénin, le Togo et le Sénégal présentent des profils moins vulnérables avec une meilleure résilience institutionnelle. La Côte d’Ivoire se distingue par des performances économiques structurelles relativement solides, mais présente des marges d’amélioration en termes institutionnels.
La pandémie de COVID-19 a illustré de manière particulièrement nette les conséquences d’un choc exogène sur les économies et les sociétés de l’UEMOA. Si les taux de mortalité sont demeurés relativement modérés, les effets économiques et sociaux ont été considérables : contraction de l’activité économique, détérioration des échanges commerciaux, accentuation des inégalités sociales et fortes tensions budgétaires. Cette crise a également révélé la fragilité des systèmes sanitaires et sociaux et souligné la nécessité urgente d’améliorer les dispositifs institutionnels de réponse rapide. En réponse à ces constats, le rapport propose plusieurs recommandations stratégiques visant à renforcer durablement la résilience des États membres. Il préconise une accélération urgente de la diversification économique, le renforcement des systèmes de protection sociale, une amélioration continue de la gouvernance publique et l’intégration systématique des risques climatiques, sanitaires et sociaux dans la planification nationale. Il insiste particulièrement sur la nécessité de maintenir dans la durée les bonnes pratiques déjà mises en oeuvre par certains pays, afin d’assurer un réel impact sur la vulnérabilité générale.
Feindouno S., Quilici L. (2025) "Vulnérabilités et résilience dans l’espace UEMOA", Rapport Ferdi, 168 p.